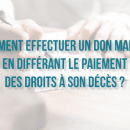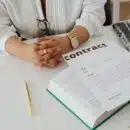FAMILLE
Comment faire pour vivre sans travailler ?
Pour vivre sans travailler, tout le monde a sûrement déjà pensé à cette possibilité le lundi matin au travail. C’est le rêve de chacun de nous de ne plus avoir ...
JURIDIQUE
Qui contacter pour se plaindre d’un notaire ?
Les notaires sont des professionnels qui ont le statut d’agents publics. Pour cela, ils sont soumis à un contrôle strict de la part de leurs supérieurs. ...
LOISIRS
NEWS
Créer une entreprise à Luxembourg : quel statut juridique ?
Le Luxembourg est un petit pays, mais très attractif pour les investisseurs étrangers où ces derniers ne manquent pas de raisons d’y créer une entreprise. Sa ...
SANTÉ
Départ à la retraite d’un salarié CESU : les informations à connaître
Votre employé à domicile souhaite prendre sa retraite au CESU… comment faites-vous ? Y a-t-il une procédure à suivre ? Et si c’est vous qui décidez de prendre votre retraite, comment procéder ? ...